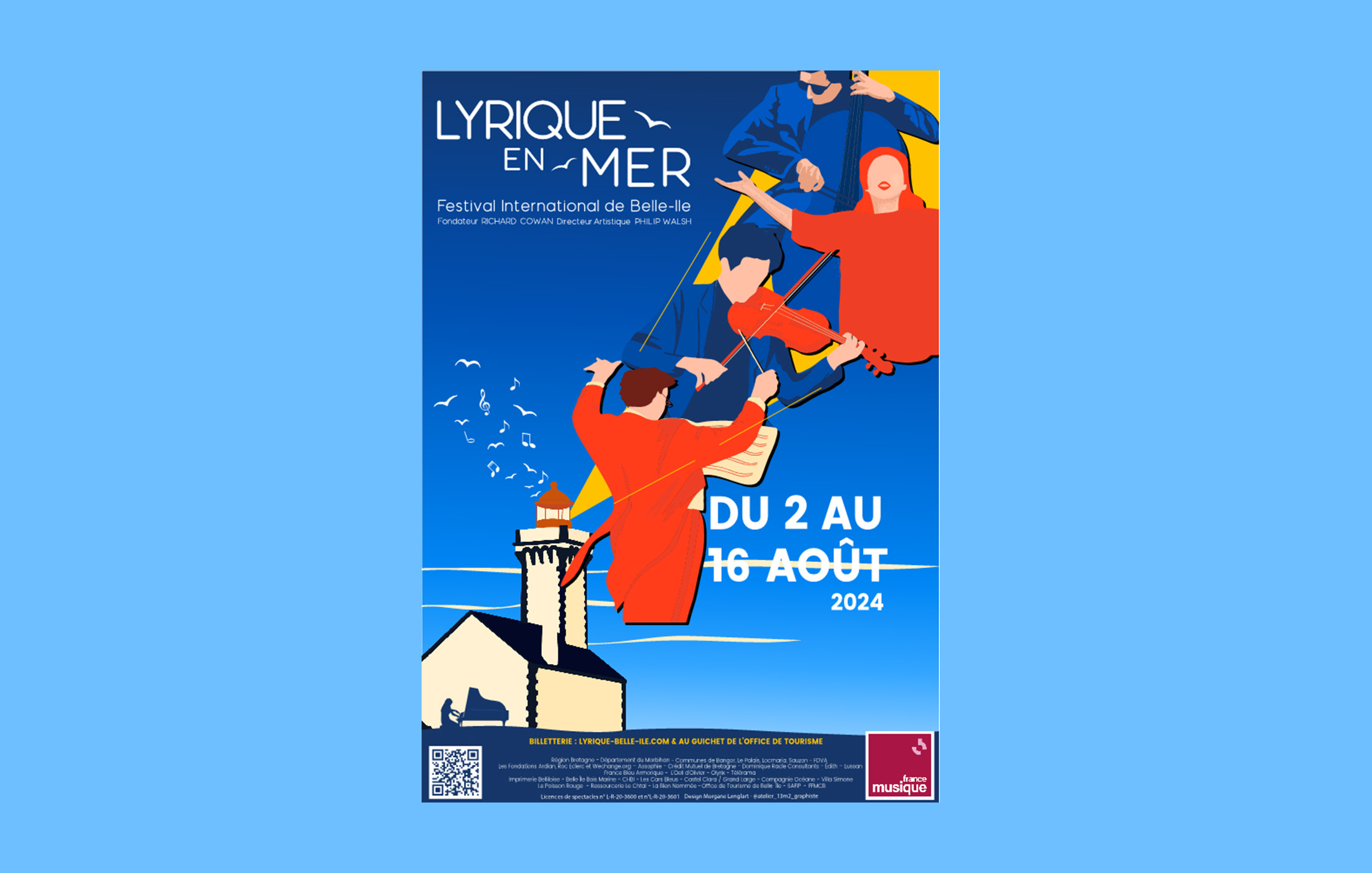« Lucrèce Borgia » de Victor Hugo
Une seule femme parmi les hommes. Une femme. Une seule femme sur la scène (la princesse Negroni et ses invitées n’étant que des « passages ».) Une seule femme parmi des hommes. Pas n’importe quelle femme : Lucrèce Borgia. Belle, cruelle, monstre sanguinaire qui n’hésite pas à faire assassiner ceux qui la défient, créature débauchée, incestueuse, sorte de Phèdre ou de Médée, tel est le portrait que nous tracent d’elle les seigneurs de Venise et de Ferrare. Mais quand Hugo ouvre son drame, c’est d’une toute autre femme qu’il semble s’agir : il nous dévoile une amoureuse. Une amoureuse d’un jeune soldat nommé Gennaro. Et ce jeune soldat est endormi là, devant elle. Elle est penchée sur lui comme une mère sur un berceau. Et c’est à la chute brutale du drame, à la fin du troisième acte, que nous apprenons, en même temps que Gennaro qui lui enfonce son poignard dans la poitrine, qu’elle est sa mère. « Mère », ce mot essentiel au drame, est ainsi son dernier mot lâché dans le sang avant de mourir. Mot libérateur, mais mot innommable. Lucrèce Borgia est une femme empêchée. Gennaro un garçon hanté, immobile et taciturne comme Hamlet.
Trois actes rapides, clairs, haletants, pendant lesquels Lucrèce lutte avec férocité contre le secret qui la dévore et dont elle ne peut se libérer, incapable qu’elle est de révéler à Gennaro qu’il est l’enfant des Borgia et qu’il porte à jamais leur nom infamant. Plus Lucrèce se tait et souffre, et plus elle devient humaine. Sublime tout autant : en s’acharnant à sauver ce fils adoré auquel elle ne peut rien avouer et que, par méprise, elle a condamné à mort, elle se magnifie.
Ce drame, le seul à autant citer la tragédie grecque (« Ion » d’Euripide notamment) et de ses archétypes, est à part dans l’œuvre théâtrale de Victor Hugo. Peut-être est-ce pour cela qu’on le voit si peu sur nos scènes. Pas d’alexandrins mais de la prose, pas d’intrigues croisées, pas de monologues, pas de « morceaux de bravoure », pas d’introspections psychologiques, la pièce rencontrera en son temps un succès populaire immédiat, hors du commun.
Encadrée par la fête, (carnaval du début, festin de la fin), la pièce mêle, comme seul Hugo sut le faire en son temps, le grotesque et le noble, le rire et la mort. L’œuvre est sombre, étouffante. Les lieux sont clos. Les personnages tendus à l’extrême. Il ne s’agira pas dans ce spectacle de reconstituer des décors Renaissance, mais de créer des espaces « guet-apens », ces lieux communs de l’horreur où règnent l’angoisse et la suspicion. Dès que Lucrèce a ôté son masque au commencement du drame, elle a fait entrer la mort sur la scène. Nous l’attendons à chaque instant.
Le costume est autre chose qu’un décor. Il fait indéniablement partie d’un monde des signes. Ici, le pourpre et le noir se côtoient, s’affrontent et se mélangent. Je veux m’efforcer à ce que sur la scène, le début du XVIe siècle italien soit « lisible » dans les costumes princiers parmi lesquels dépare, « anomalie remarquable », l’habit terne de soldat porté par Gennaro.